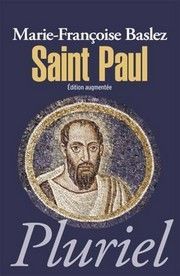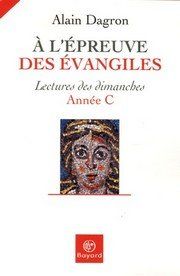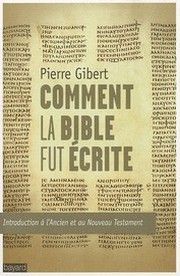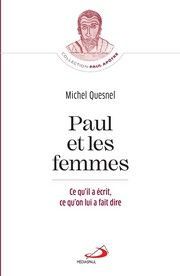A l'épreuve des évangiles
Lectures des dimanches - Année B
Alain Dagron
Ed. Bayard, 2005
Texte de la 4ème de couverture :
Cette approche des évangiles des dimanches (année liturgique B) réussit à nous entraîner hors des sentiers battus de la paraphrase et du moralisme. L'attention à la matière du texte des évangiles, à ses aspérités, à ses détails insolites, à ses silences et répétitions, nous en renouvelle l'accès et l'expérience.
Invitation et ici faite au lecteur à reprendre à frais nouveau le travail de lecture des évangiles sans lequel ils risquent fort de demeurer lettre morte.
Alain Dagron est curé du diocèse de Bordeaux. Il a été aumônier de lycées et collèges, responsable de l'aumônerie d'étudiants, aumônier d'hôpital psychiatrique. Il anime des groupes de lecture biblique. Ses lectures d'évangile rencontrent un vif succès lors d'émissions diffusées depuis 2000 sur RCF Bordeaux.
Préface de Mgr. Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, président de la Conférence des évêques de France (2005)
Livre épuisé
La maison d'édition ayant rendu les droits à l'auteur, nous en publions le contenu sur ce site à la page "A l'épreuve des évangiles"